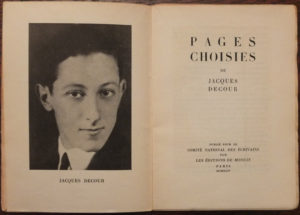Un cadeau de Noël: le livre d’Ivan Denys, Lycéen résistant
Extrait:
“Des horreurs de l’Occupation, ce qui m’est le plus pénible à évoquer, c’est la persécution des Juifs, profondément ressentie dans la mesure surtout où, parmi mes condisciples et amis les plus proches, se trouvait Wladimir Solomon, qui fut mon camarade de classe en seconde et en première (pas en terminale, car alors il avait dû se cacher, et donc abandonner ses études). Parmi les moments les plus marquants que j’ai vécus avec lui, j’en citerai trois que j’ai toujours à l’esprit. Le premier, c’est ce jour de mai 1942 où, comme tous les Juifs de plus de six ans, il dut porter en permanence l’étoile jaune, qui devait les distinguer et les désigner à la haine et au mépris. Je ne pense pas, même si j’ai rappelé les tendances antisémites qu’on trouvait chez beaucoup de Français avant la guerre et en particulier au lycée Janson-de-Sailly, bourgeois et bien-pensant, que cette intention du gouvernement de Pétain ait été généralement approuvée. Le jour où Wladimir Solomon – que, dans ma classe, on appelait affectueusement “Solo” – arriva en cours en seconde A3 avec cette étoile cousue au revers de son veston, l’ensemble de la classe lui manifesta sa sympathie en l’applaudissantet plusieurs d’entre nous se fabriquèrent une étoile jaune en papier ou en carton et la portèrent plusieurs jours, au lycée et même dans la rue. Dans la classe, une seule réaction désagréable, d’un garçon un peu bizarre, qui me parut infâme sur le moment mais qui venait sans doute d’un simple mouvement d’humeur : il cria à Wladimir dans les escaliers: — Tu ne peux plus nier qui tu es ! Je le pris à partie, mais il vint parler avec Solo et ils discutèrent amicalement les jours suivants. À dater de ce jour, nous étions tout un groupe à raccompagner aux sorties de classe notre ami, de la rue de Longchamp jusqu’au square Lamartine et à la rue Dufrénoy où il habitait avec son père, son jeune frère et une vieille nounou qui ne parlait que le russe – il avait perdu sa mère de maladie quelque temps auparavant. J’allais parfois chez lui et il venait assez souvent chez moi, où nous travaillions ensemble et où il lisait pendant des heures en français ou en russe – j’ai rarement connu ami qui lise autant que lui. Un jour qu’il venait de me quitter, je vis arriver son père qui me dit, avec un très fort accent russe, ou plutôt yiddish :
— Vous ne devez pas continuer à voir Wladimir, car nous sommes gifs et nous n’avons pas les mêmes droits que vous. C’est dangereux pour vous. Je fus bouleversé par ces propos, qui semblaient montrer comme une culpabilité. En tout cas, il se sentait différent des autres. Je continuai évidemment à voir Wladimir tous les jours, à l’inviter chez moi et à l’accompagner après la classe. Et quand, plus tard, il dut se cacher, j’allais régulièrement avec Phoebé et d’autres amis lui porter à manger et à lire dans son refuge inconfortable du septième étage de la rue des Dardanelles, où il resta enfermé durant presque un an et demi, jusqu’à la Libération.”